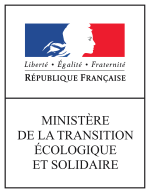Ce reportage nous présente comment personne n’échappe à ce pesticide largement répandu des décennies partout sur la planète : ainsi une quinzaine de citoyens ont ainsi été recrutés au hasard pour tester la présence de glyphosate dans leur urine, tout comme une sélection de personnalités – sportifs, médecins, acteurs, etc. La présence du glyphosate est généralisée et si le test n’a bien sûr pas valeur d’évaluation du risque réel, au moins montre-t-il qu’il est à peu près impossible d’échapper au célèbre herbicide et dont il n’existe pas de seuil minimal. Il en est épandu 800 000 tonnes par an sur la planète dont 8000 en France.
Fin 2017, Emmanuel Macron promettait, que le glyphosate serait interdit en France « dans trois ans au plus tard ». Cette affirmation présidentielle a déclenché une forte activité parlementaire, des députés de la majorité s’empressant d’appeler à l’inscription, dans la loi Egalim (découlant des Etats généraux de l’alimentation ), mais le gouvernement a vite réalisé que la promesse serait difficile à tenir : c’est pourquoi l’inscription dans une loi a été repoussé.
Rappelons que le glyphosate constitue le principe actif d’herbicides comme le Roundup, suspecté d’être cancérigène. Or l’une des formulations sur les 400 du fameux Roundup vient d’être interdit , mais l’utilisation des autres se poursuit malgré toutes les études sous entendant des risques. Par ailleurs depuis le 1er Janvier, les particuliers et jardiniers amateurs ne peuvent plus se procurer de produits à base de pesticides de synthèse, comme le célèbre herbicide de Monsanto.
A l’heure actuelle 1000 personnes sont en procédures contre Monsanto dans le cadre de Class Action, l’une d’elle ayant abouti dernièrement même si la firme fait appel.
Vous pouvez voir le déroulement des actions menées :
Glyphosate : comment s’en sortir, présenté par Elise Lucet (Fr., 2018, 110 min). www.francetvinfo.fr