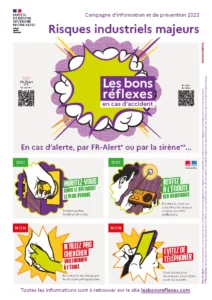Après une première semaine de COP déjà bien chargée, essentiellement axée sur les débat techniques, c’est désormais le moment des bilans.
Dès les premières heures de la conférence, fait rarissime, mais il a été complété d’un accord aussi express qu’inattendu sur le Fonds pertes et préjudices esquissé à la COP 27. Les besoins sont évalués à 580 milliards de dollars , or il est prévu que chaque année 726 millions de dollars soient attribués d’ici à 2030 pour faire face aux pires impacts du changement climatique, comme la montée des mers ou la désertification.
Le fonds pour l’adaptation, parent pauvre des financements climat, récolte, quant à lui, 133 millions de dollars, mais cet ajout survient après une diminution de 14 % entre 2020 et 2021. Un rapport des Nations unies estime que 387 milliards de dollars par an seraient en réalité à prévoir.
François Gemenne, coauteur du sixième rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) et désormais professeur à l’École des hautes études commerciales de Paris (HEC). s’est exprimé ainsi « Les résultats engrangés jusqu’ici sont déjà nettement supérieurs à ceux de la COP 27 et de la COP 26 »
Par ailleurs, 124 pays se sont engagés à multiplier les énergies renouvelables par trois à l’horizon 2030 et à doubler le rythme annuel de progression de l’efficacité énergétique. Par ailleurs la France a proposé à une vingtaine de pays de s’ engagés à tripler les capacités du nucléaire en 2050 et à flécher plus d’investissements vers cette filière .
Attendons la fin de cette rencontre pour en tirer les conclusions finales.