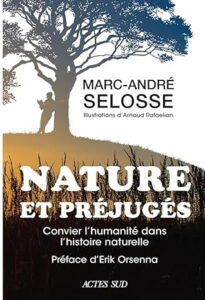Tous les articles par Jacqueline Collard
Un nouvel ouvrage du Pr Belpomme Le Cancer : d’hier et d’aujourd’hui
Le Cancer : d’hier et d’aujourd’hui
Des progrès dans la pratique des soins mais l’accroissement persistant du fléau
Ce livre s’adresse à tous, d’abord aux malades et à leur famille, mais aussi aux médecins, aux professionnels de santé et aux responsables politiques. La pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine n’ont pas effacé le fléau Cancer.
Car la survenue des cancers est liée principalement à la pollution physique, chimique et microbiologique de notre environnement, et rien n’est fait ou presque à son encontre, c’est-à-dire qu’aucune prévention environnementale n’est réellement mise en œuvre. C’est pourquoi, comme nous le verrons, il nous faut impérativement réformer l’Institut national du cancer, l’INCa, que j’ai contribué à créer, et informer les responsables politiques sur cet état de fait.
Puisse ce livre contribuer à donner de l?espoir aux malades, et éclairer les cancérologues et hommes politiques, sur ce qu?il leur reste à accomplir. En médecine, toute innovation, thérapeutique ou tout nouveau concept, en raison de la persistance des préjugés se solde d’abord par l’opposition de la communauté médicale avant d’être acceptée, puis reconnue comme évidente. C?est ce que Jean Bernard pensait. C’est bien ce que nous constatons aujourd’hui.
Face aux modifications de notre environnement et à ses menaces, c’est autrement qu’il nous faut aujourd’hui envisager la lutte contre les maladies, et en particulier les cancers, au double plan médical et politique. Puisse ce livre y contribuer.
Date de parution : 12-2024 Ouvrage de 255 p. À paraître chez Lavoisier Coll. MEDECINE
Sécuriser l’accès à l’eau potable : une nécessité !
La sanctuarisation des aires d’alimentation de captages d’eau dans l’objectif d’une transition agroécologique, s’avère de plus en plus pressante compte tenues des multiples pollutions des milieux : qu’elles proviennent des sites industriels ou du monde agricole.
Les agences de l’eau accompagnent de nombreuses initiatives qui mobilisent des moyens financiers et humains considérables pour réduire les risques de pollution de l’eau. Elles s’avèrent pourtant insuffisantes au regard de l’inertie en matière de réglementation sur l’usage des pesticides, comme sur d’autres polluants. Certaines molécules, impossibles à éliminer raisonnablement aujourd’hui pour des raisons techniques et financières, sont à l’origine de plusieurs fermetures de captages alors que l’eau manque d’autant que le changement climatique accentue les problèmes d’accès à l’eau.
Les populations riveraines des zones agricoles peuvent être concernées par la dérive des produits épandus sur les cultures. En effet, des études suggèrent une influence de la proximité aux zones agricoles sur la contamination par les pesticides du lieu de vie, variable selon les substances, leur mode d’application et la manière d’estimer l’exposition. Ces questions relatives aux liens entre une exposition aux pesticides et la survenue de certaines pathologies s’inscrivent dans une complexité croissante, la littérature faisant apparaître une préoccupation concernant les effets indirects de certains pesticides sur la santé humaine par le biais des effets sur les écosystèmes.
Ces cinq dernières années, la recherche de polluants dans l’eau s’est intensifiée et a ainsi révélé la dégradation massive de la qualité des eaux. Le risque sanitaire et environnemental de ces multiples pollutions est élevé compte tenu de l’ampleur de la contamination et des incertitudes qui pèsent sur leurs effets cumulés.
https://www.inserm.fr/expertise-collective/pesticides-et-sante-nouvelles-donnees-2021/ Résumé de l’expertise collective Pesticides et santé –
Le tatouage populaire mais pas anodin
Le tatouage est devenu très populaire en France. Le tatouage n’est pas un acte anodin. Avant de sauter le pas, il est essentiel d’être bien renseigné sur la réglementation en vigueur et les risques encourus Près d’un Français sur cinq est tatoué, soit deux fois plus qu’au début des années 2010. La prévalence est de 20 % en Europe, selon la récente étude TABOO de 2023. Cependant, l’encre de tatouage et ses constituants persistent dans l’organisme pendant de nombreuses décennies, principalement au niveau des ganglions.
Les chercheurs expliquent : « Les encres de tatouages contiennent très souvent des produits chimiques carcinogènes, tels que les amines aromatiques primaires (dans les encres colorées), les hydrocarbures aromatiques polycycliques (encres noires) et des métaux (nickel, cobalt…). Le processus de tatouage déclenche une réponse immunologique qui provoque la translocation de l’encre de tatouage depuis le site d’injection.
D’ores et déjà, l’étude souligne l’importance de mesures réglementaires pour contrôler la composition chimique de l’encre de tatouage.
Comme toute profession, les activités de tatouage, perçage corporel et maquillage permanent répondent à des obligations réglementaires. Ainsi, la mise en œuvre d’une telle activité engage le professionnel à déclarer son activité auprès de l’ARS et à respecter des règles d’hygiène et de salubrité strictes décrites dans cette page.
Les produits et pratiques de tatouage et de détatouage peuvent présenter divers risques pour la santé. Se faire détatouer est difficile et coûteux. Le détatouage ne peut être
réalisé que par un médecin.
Le HCSP émet 45 recommandations relatives aux produits et pratiques du tatouage et du détatouage pour garantir le bon acte réalisé par le bon professionnel avec le bon produit, auprès de la bonne personne, avec une bonne information et un bon suivi.
Risques des produits et pratiques de tatouage et de détatouage (hcsp.fr)
Tatouage et piercing – Ministère du travail, de la santé et des solidarités (sante.gouv.fr)
Le cyberharcèlement devient un problème de santé publique
A la rentrée 2023 le harcèlement scolaire est devenu cœur de l’actualité, un fléau de plus en plus présent, nombre de parents s’inquiètent pour leur enfant, avec la peur de passer à côté de sa souffrance.
Selon un rapport du Sénat, on estime le taux de harcèlement autour de 6 % des élèves. Les chiffres de l’Unicef France sont plus pessimistes. Selon l’organisation, un enfant sur deux se disait victime de harcèlement dès 7 ans, et un adolescent sur quatre à 18 ans. Du côté de l’Unesco, on estimait en 2019 que le harcèlement touchait 22 % des élèves. Plusieurs réalités cohabitent dès lors : des violences verbales ou morales (surnoms méchants, insultes, moqueries, brimades, rejet du groupe…), des violences physiques (bousculades, coups), des vols. Une situation qui va de plus en plus de pair avec un cyberharcèlement (via des sms, sur les réseaux sociaux…).
Repli sur soi, harcèlement caché à la maison, changement d’humeur, de comportement, il est nécessaire d’être attentif aux signes si l’enfant tait le calvaire qu’il vit à l’école ou en dehors de celle_ci. Pour accompagner ces parents, le ministère de l’Intérieur a mis en place une « grille d’évaluation du danger face au harcèlement entre jeunes ».
Une étude récente vient d’être présenté au congrès d’allergologie liant les allergies alimentaires au cyberharcèlement
Votre enfant est harcelé à l’école ? Joignez le 3020 pour signaler une situation de harcèlement à l’école, le 3018 s’il s’agit d’un cyberharcèlement. Votre enfant ou vous-même peut informer la direction de l’établissement, porter plainte au commissariat ou à la gendarmerie. « Tout membre du personnel éducatif (enseignant, proviseur…) qui a connaissance de faits de harcèlement doit avertir sans délai le procureur de la République », précise encore le site service-public.fr.
- Signalez les contenus, les messages, les commentaires qui portent atteinte à votre enfant. Connectez-vous à la plateforme Pharos (internet-signalement.gouv.fr) ou au site Point de contact (http://www.pointdecontact.net) pour signaler les contenus illicites.
- Prenez rendez-vous avec l’école, le collège ou le lycée de votre enfant afin de faire part de la situation, de manière détaillée.
Clépsy.fr – service-public.fr – Harcèlement scolaire et cyberharcèlement : mobilisation générale pour mieux prévenir, détecter et traiter, senat.fr – Grille d’évaluation du danger face au harcèlement entre jeunes, ministère de l’Intérieur
Ali-03-CO/ M. Lelot, F. Forgerit, A.C. De Menibus et al. Étude descriptive, prospective, multicentrique, sur le harcèlement scolaire chez les collégiens porteurs d’une allergie alimentaire (CFA, avril2024, Paris)