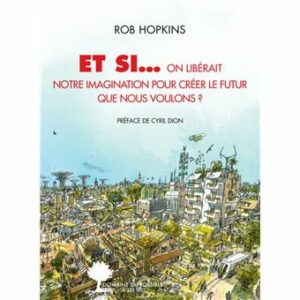3 ans se sont écoulés depuis le rapport du Défenseur des droits dématérialisation et inégalités d’accès aux services publics. Durant ces 3 années, la transformation numérique de l’administration et des services public s’est poursuivie, entrainant une évolution profonde de la relation à l’usager. Dans le même temps, les politiques d’inclusion numérique ont tenté d’accompagner ces changements, particulièrement auprès des publics les plus vulnérables.
Les délégués et les juristes du Défenseur des droits continuent de recevoir des réclamations toujours plus nombreuses, preuve que le mouvement de numérisation des services se heurte encore aux situations des usagers. En 2021, près de 115 000 réclamations ont été adressées à la Défenseure des droits dont 91 000 concernent les services publics, selon les chiffres publiés dans le rapport présenté par l’autorité indépendante le 16 février 2022.
Ce rapport présente le suivi sur les inégalités d’accès aux droits provoquées par des procédures numérisées à marche forcée. Par ailleurs, la Défenseure des droits constate que la charge et la responsabilité du bon fonctionnement des démarches repose souvent sur l’usager : « l’usager doit s’informer, s’orienter, remplir seul des formulaires en ligne, mettre à jour son navigateur, s’adapter aux changements de sites, numériser des documents« . Plébiscitée par le gouvernement, la dématérialisation présente un bilan en demi-teinte. Sous couvert de rapidité et facilité, l’Etat s’est déchargé sur les usagers qui doivent désormais effectuer seuls leurs démarches, au risque d’échouer et de renoncer à leurs droits.
*LDH: Ligue des droits de l’homme
https://www.vie-publique.fr/en-bref/283882-dematerialisation-des-services-publics-des-usagers-en-difficulte