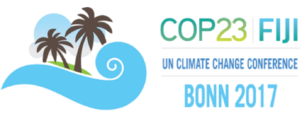En cette période où les nappes phréatiques doivent se rechargées elle affichent des niveaux trés bas: 71% des nappes souterraines affichent un niveau modérément bas à très bas, selon le communiqué publié le 17 novembre par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM).
La prolongation d’une situation de basses eaux n’est pas totalement habituelle pour cette période de l’année. La situation est assez dégradée en l’absence de premières pluies automnales importantes. Plusieurs secteurs présentent des niveaux autour de la moyenne comme le sud du Bassin parisien ou sur la partie ouest du bassin Adour-Garonne. Le reste du territoire présente des niveaux modérément bas voire bas.
La vallée du Rhône au sud de Lyon ainsi que le secteur du Périgord et du bassin Angoumois présentent quant à eux des niveaux très bas. Le déficit de pluviométrie, est remarquable sur la quasi-totalité du pays, il est record sur la région Provence – Alpes – Côte d’Azur. Songeons que notre région s’appuie sur des réserves d’eau pour fournir en Energies renouvelables et que les barrages sont trés peu chargés, il en est de même pour le refroidissement des centrales nucléaires qui s’appuient sur le débit du Rhône anormalement bas.
On peut cependant espérer que les futures précipitations d’hiver vont améliorer la situation.