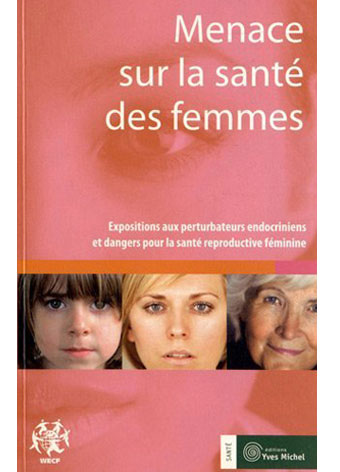Nous rapportons ici le communiqué de presse émanant du Parlement européen sur les menaces transfrontalières potentielles sur la santé des Européens:
Les menaces transfrontalières graves pour la santé seront mieux encadrées
Le Parlement européen réuni en session plénière a adopté aujourd’hui le 3 juillet 2013 avec une large majorité le rapport sur les menaces transfrontalières graves pour la santé (2011/0421(COD)). Ce texte vise à mieux encadrer à l’avenir la capacité de réponse de l’Union européenne en tirant les enseignements des crises sanitaires comme la pandémie de grippe A (H1N1) de 2009, le nuage de cendres volcaniques de 2010 ou encore l’apparition de foyers d’infection à E.Coli de 2011.
Michèle RIVASI, vice-présidente du Groupe des Verts/ALE au Parlement européen, revient sur l’intérêt de ce texte: Continue reading