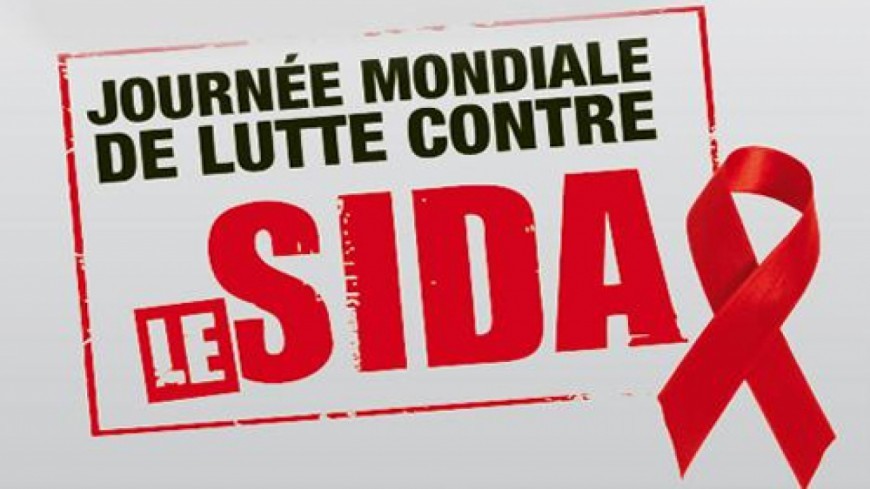Le 31 octobre 2017, l’ONU nous alertait solennellement sur l’écart « catastrophique » qui existe entre les engagements des Etats et les réductions des émissions de gaz à effet de serre qu’il faudrait opérer pour maintenir le réchauffement au-dessous de 2 °C. « Les engagements actuels des Etats couvrent à peine un tiers des réductions nécessaires, soulignait Erik Solheim, directeur du Programme des Nations unies pour l’environnement. Gouvernements, secteur privé, société civile doivent combler cet écart catastrophique. Un an après l’entrée en vigueur de l’accord de Paris, nous sommes loin de faire ce qu’il faudrait pour préserver des centaines de millions de personnes.
« Aucun d’entre nous n’est aujourd’hui à l’abri de la pollution, c’est pourquoi nous devons tous passer à l’action. » Tel est le message du directeur du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), Erik Solheim. Il résume le leitmotiv de la troisième assemblée des Nations unies pour l’environnement qui s’est ouverte à Nairobi, lundi 4 décembre, sur le thème de la pollution.
Dans un rapport intitulé « Vers une planète sans pollution », Erik Solheim dresse une liste de cinquante mesures à prendre d’urgence pour s’attaquer aux problèmes de dégradation de l’environnement qui, rappelle-t-il, sont à l’origine de quasiment un décès sur quatre dans le monde. Pollution de l’air, des eaux, des sols mais aussi générée par les produits chimiques et les déchets, les propositions visent toutes les sources et tous les modes de contamination.
La première recommandation est d’« élaborer des politiques et des stratégies sur la qualité de l’air aux niveaux infranational, national et régional pour se conformer aux directives de l’Organisation mondiale de la santé [OMS] ». Aujourd’hui, de nombreux pays ne disposent pas de normes en la matière, et même l’Europe ne respecte pas les recommandations de l’OMS. Ainsi, l’Union européenne fixe une limite d’exposition aux particules fines (PM2,5, inférieures à 2,5 µm) à 25 µg/m3 en moyenne annuelle quand l’OMS recommande un seuil de 10 µg/m3.
Maria Neira Directrice du département santé publique et environnement à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime qu’il est temps de changer de stratégie et de faire de la lutte contre ses impacts sanitaires l’axe central de la mobilisation contre le changement climatique.Et ce n’est pas faute d’avoir alerté, avec l’OMS, sur ces chiffres terribles : 6,5 millions de morts prématurées chaque année dans le monde sont liées à l’exposition à un air contaminé. On ne pourra pas dire qu’on ne savait pas. Il y a comme une sorte de refus à accepter une autre alerte globale en plus de celle sur le changement climatique.